Détour par Rock en Seine
Le dernier festival où je suis allé était le Guess Who, en 2019. Je m’étais vaguement promis d’y retourner dès l’année suivante, et de ne jamais revenir dans les festivals monstrueux de l’été pour privilégier les initiatives plus modestes et plus intéressantes.
Puis il y a eu la pandémie, l’entrée dans la vie active, et deux éditions du Guess Who que j’ai raté. Et il y a deux jours, je suis tombé par hasard sur un tweet qui parlait de Rock en Seine. La daronne me suggérait d’y aller vu que je rentrais à Paris la journée qui m’intéressait le plus. Je laissais tomber très vite puisque je me disais que la journée était complète. Et je m’étais planté : la journée était loin d’être complète – il y avait encore des places dispo le soir même ! Alors je me suis bougé le cul, j’ai paniqué pendant 45 minutes devant un site surchargé, et j’ai payé une place à 50 balles. Sur un coup de tête.
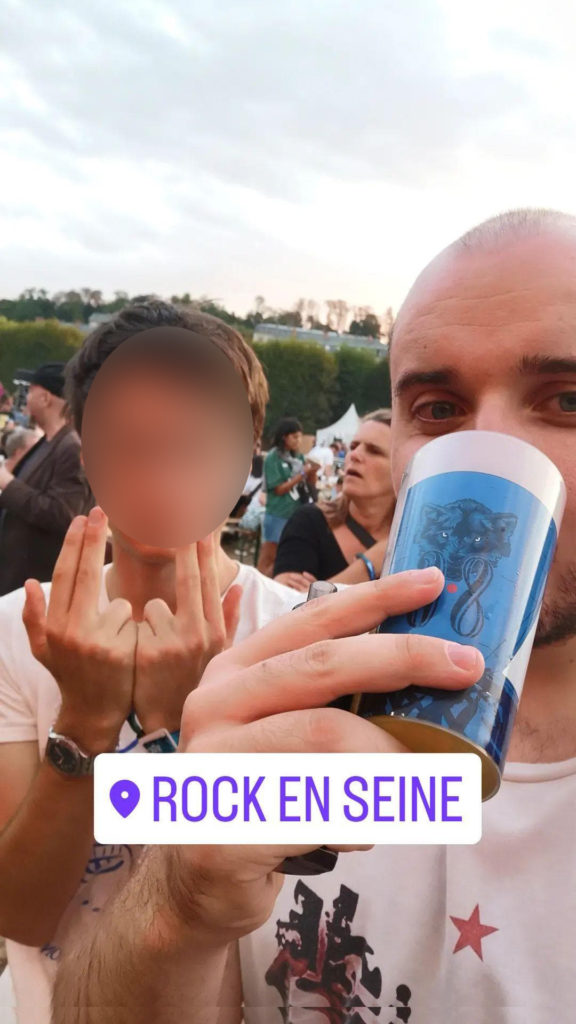
Je n’avais pas les moyens, et je ne vais pas vous mentir, entre le trajet Lille-Paris avancé de plusieurs heures au dernier moment, le billet et les 50 euros mis sur le bracelet cashless, je me suis probablement mis dans une merde noire niveau thunes. Mais je sais que ça en vaut la peine. Trop de groupes dingues et l’occasion était trop belle de conclure mes vacances en beauté.
Après avoir, miracle, dormi comme un bébé cette nuit-là, j’enchaine sur mon Lille-Paris arrivé avec 30 minutes d’avance et j’arrive par miracle à entrer encore plus dans les temps que ce que je pensais, autour de 17H30. Le temps de bouffer un bagel tout sec et des frites grasses pour le prix de deux kebabs, je rejoins le copain Marin, que je connais assez vaguement mais que je sais de bonne compagnie. Je regarde DIIV de loin alors qu’il est en plein moshpit et c’est un début de festival absolument carré, il fait beau, j’ai deux bières dans les mains, j’ai pas galéré à rentrer et j’ai absolument rien de prévu le lendemain donc je peux être en mode no limit.

Concernant la musique, DIIV était en effet bien rigolo, la forme la plus bourrine de l’indie rock des 10-15 dernières années avec une dégaine bien slacker. On se bouge lentement pour discuter en allant regarder les Liminanas de très très loin. Là, c’est déjà moins cool : le son est vraiment pas bon même si on entend à peu près tous les instruments, ils ont l’air assez indifférents à ce qu’il se passe et aucun guest ne se présente pendant le concert. “Dimanche” sans Bertrand Belin et “Istanbul Is Sleepy” sans Anton Newcombe, c’est tout de suite moins stylé. Pourtant, quand on se laisse porter par le truc, leur musique a toujours ce quelque chose de réjouissant, pour peu qu’on aime se bouger sur une musique absurdement répétitive. Les deux Highlights sont pour moi les deux reprises : “Mother Sky” de Can sauce psyché années 80, et, plus étonnant et limite drôle, “Teenage Kick” des Undertones. La seconde était certes complétement à coté de la plaque, mais même une mauvaise reprise des Undertones est un bon moment.
Je fais un détour par James Blake sans m’attendre à rien, puisque je ne l’ai pas écouté depuis un bout de temps et que ce qu’il sort actuellement à tendance à m’endormir. Pourtant, je suis surpris en arrivant de l’entendre enchainer des morceaux de ses deux premiers albums, et même un morceau plus ancien. Et j’ai trop écouté “Limit to Your Love” pour ne pas me laisser porter par le timbre chaud de ce beau gosse, alors je me laisse prendre au jeu même si je profite du concert pour le contrôle technique obligatoire du début de soirée : on enlève les pompes, on bois de l’eau, on recharge le téléphone et on prépare le reste de la soirée.
Après avoir vu James Blake conclure son set par “Godspeed”, reprise de Frank Ocean, Marin et moi nous rejoignons pour qu’il puisse se sustenter d’un abominable panini jambon-fromage et de frites qui collent aux doigts, et on fait un détour par le set fun de Klangstof. Vendus comme un truc rappelant Sigur Ros, Radiohead et Alt-J, le groupe ne ressemble littéralement à aucun des trois, même si on peut éventuellement entendre un air de Thom Yorke qui se serait mouché chez le chanteur. De l’indie rock ample et joli, avec un dernier morceau réellement réussi.

Et là, le dilemme. Je quitte Marin qui veut enchainer Squid, Kraftwerk, puis Nick Cave. Perso, j’étais plus ou moins venu pour Nick Cave, mais j’avais vraiment, vraiment le seum de rater Kraftwerk. Alors je suis parti voir au moins quelques morceaux du légendaire groupe allemand, et ce que j’ai vu était extraordinaire. Sauf que je n’ai vu que “Die Roboter”. Je ne pouvais pas me permettre de voir Nick Cave & The Bad Seeds derrière 5000 personnes. C’était un vrai rêve de gosse de voir ce groupe que j’écoute depuis bientôt 10 ans. Alors j’ai fait demi-tour et je suis allé voir Nick Cave.
Bien m’en a pris, les 15 premiers rangs étaient déjà blindés. Et ils ne seraient pas aussi pleins si cette saloperie de Golden Pit à moitié vide presque toute la journée ne prenait pas 70% du devant de la scène… Un pur scandale et une manière de segmenter le public entre gens blindés et public “normal”. Même le Primavera, même Coachella (pourtant le paradis des influenceurs venus vendre leur outfit et prendre des selfies en portant des coiffes indiennes) n’avaient pas osé. Mais on fait avec et les morceaux les plus énervés nous permettrons de jouer des coudes.
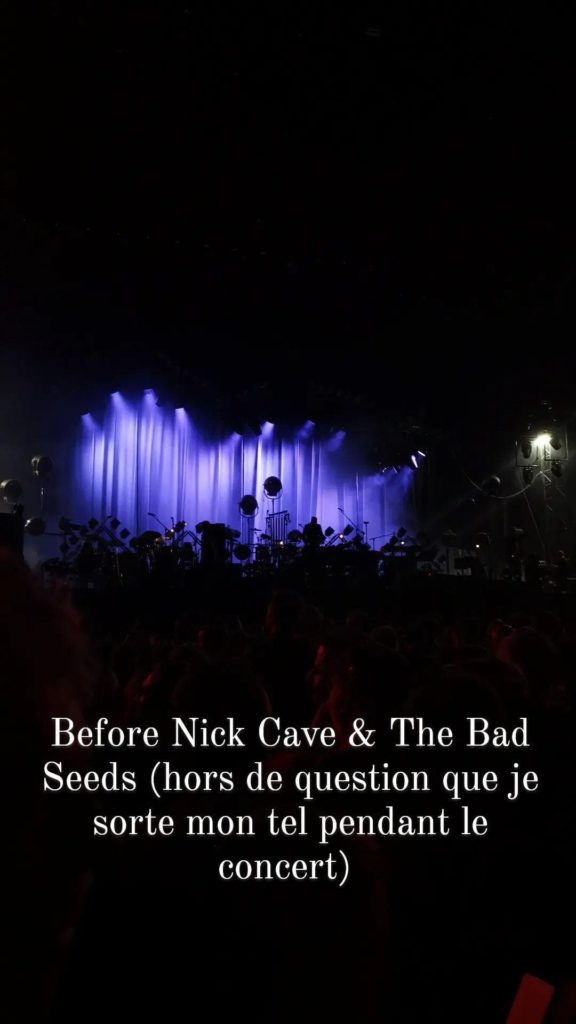
Le concert de Nick Cave & The Bad Seeds s’est ouvert sur deux morceaux que je n’aimais pas, “Get Ready For Love” et “There she goes, my beautiful world”. Deux morceaux issus d’un de leurs albums les plus faibles, Abbatoir Blues / The Lyre of Orpheus, et deux morceaux mixés n’importe comment, dans une soupe de son absolument inaudible où je distinguais seulement la caisse claire et la voix de Nick Cave. Il y a de meilleures manières de commencer, même si je reconnais que “Get Ready For Love” permet d’ouvrir sur un sacré banger.
Et pourtant. Passé cette entrée en matière pour le moins pénible, on assiste tout simplement à une masterclass. Il y a toujours quelque chose de gênant à fétichiser cette attitude de star virile, mais il faut reconnaître l’immense charisme de Nick Cave, sa capacité à capter l’attention de milliers de personnes en quelques secondes. Alors que derrière lui se trouvent des musiciens exceptionnels (je les reconnait presque tous : Warren Ellis, Georges Vjestica, Jim Sclavunos… Seule la nouvelle venue, une claviériste prenant la place du regretté Conway Savage, plus ou moins la première femme de l’histoire des Bad Seeds, m’est inconnue), ils sont volontairement effacés pour donner plus de place à la présence scénique de cet homme étrange, insupportable, beau, vieillissant, hypnotisant.
Nick Cave a clairement cela pour lui : s’il a mis très longtemps à devenir ce qu’il est, il est aujourd’hui indéniable qu’il est Nick Cave. La personnalité ambigüe, complexe qu’il s’est forgée ne lui colle plus à la peau, elle est sa peau, et rien que le regarder marcher, jeter son micro pour s’asseoir au piano, se pencher sur le public, prendre la main des hommes et des femmes, les toucher et se laisser toucher, toute cette mise en scène virile et un peu passéiste du rockeur de légende entrant en connexion avec son public, tout cela a quelque chose de proprement, absolument fascinant.
Tous ces morceaux que j’ai chanté seul, tard le soir en rentrant, dont les performances scéniques m’ont fasciné, ces chansons que je rêvais de voir un jour en concert, elles sont toutes là, dans un set généreux et impérial, en forme de best of d’une remarquable cohérence, du sec et tendu “Tupelo” à l’épique “White Elephant”. En fait, alors que Nick Cave a souvent été remarqué pour l’intensité nerveuse de ses concerts, ce qui a peut-être changé ces dernières années, c’est la mise en valeur de la puissance émotionnelle des chansons. Et les concerts de Nick Cave sont passés de la nervosité, la tension, la colère, à une grande communion où le chanteur et le public sont liés par la joie, la catharsis – une façon de voir la performance scénique qu’il mettait souvent en valeur dans les différents documentaires qui lui ont été consacrés ces dernières années.
Le set se conclue sur “Vortex”, seule chanson que je ne connaissais pas du concert, loin d’être la meilleure de leur répertoire mais qui a l’intérêt de sonner comme un générique de fin. Que retenir alors : laisser les souvenirs s’imprégner, déjà, ne pas chercher chaque photo, chaque vidéo, chaque tweet remplacer les souvenirs que nous nous sommes forgés : Comme le disait Nick Cave, “memory is what we are”, et il serait de mauvais goût de voler, en quelque sortes, les souvenirs des autres. On retiendra aussi une organisation parait-il bien plus carrée que celle de la veille, et effectivement on a jamais attendu plus de quelques minutes pour prendre une bière, aller pisser ou boire un peu d’eau. On retiendra que tout était trop cher, on retiendra les cloques au pied, on retiendra ce maudit golden pit et un ou deux concerts prodigieux.
Promis, c’est la dernière fois que je fous les pieds dans ce genre de gros machin.
