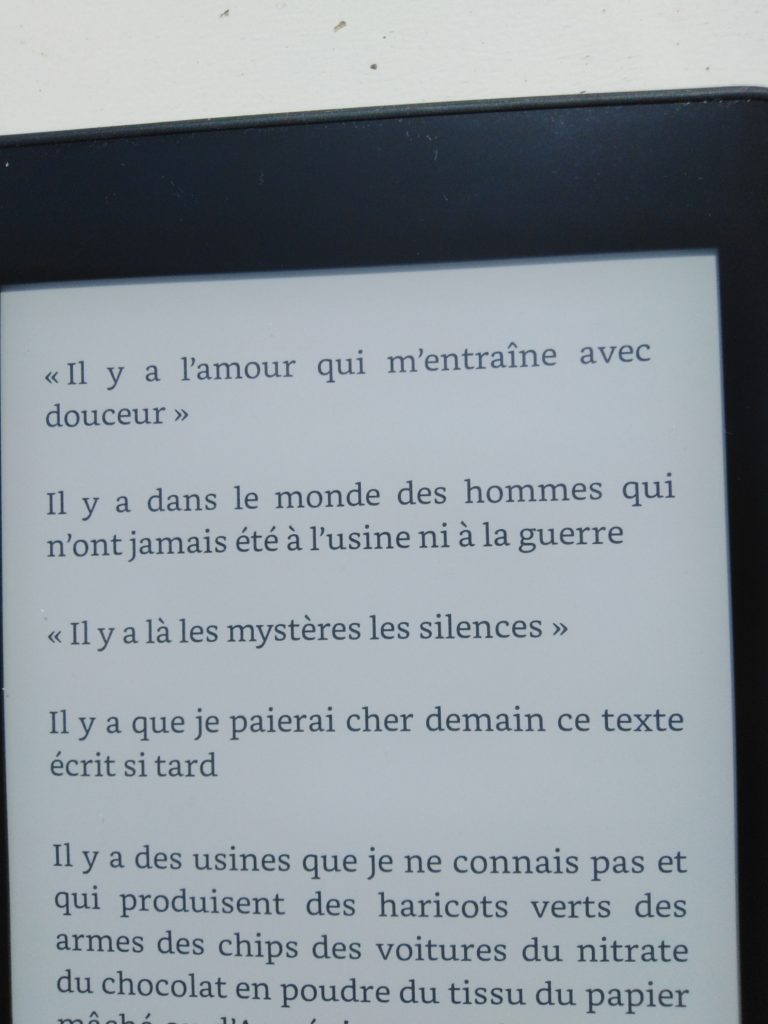Joseph Pontus – À la ligne
Je ne lis que très peu de littérature. De poésie, de romans. Pour l’essentiel, je me consacre à la lecture d’ouvrages de sciences humaines et sociales, d’histoire, de sociologie, de philosophie, éventuellement d’économie ou de géographie à l’occasion. Je crois que j’ai aujourd’hui dans une certaine mesure laissé de côté la littérature par une sorte de culpabilité, comme si en ayant repris mes études je me sentirais coupable de ne pas lire quelque chose qui ait un rapport, même lointain, avec mes études. J’arrive parfois à joindre l’utile à “l’agréable” (pour ce qu’il y a d’agréable à lire Adorno…), mais dans le cadre de la littérature, c’est bien compliqué.
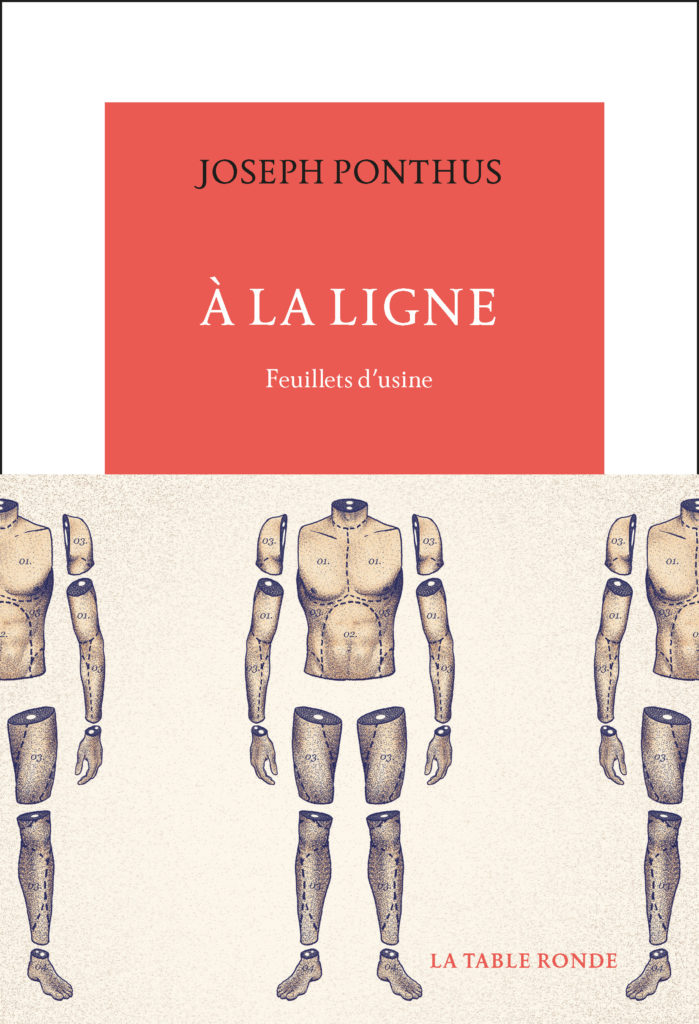
Mais il m’arrive parfois de pouvoir me dégager un peu de temps pour me lancer dans la lecture d’un truc différent. La période actuelle m’avait donné envie de me lancer dans un roman, un truc plus simple, quelque chose qui se lirait de manière fluide et ou que je n’aurais pas forcément à feuilleter à nouveau. Ce sera À la ligne, de Joseph Pontus. Je ne sortais pas trop de mes obsessions ou mes préoccupations : le dernier roman que j’avais lu était L’Établi de Robert Linhart.
J’avais entendu parler de ce roman d’une manière particulière : j’apprenais, fin 2019, que le prochain projet de Michel Cloup serait une adaptation musicale de ce roman, dans des lectures-concerts ou il serait accompagné de Miossec, puis de Pascal Bouaziz. Le projet, déjà secoué par le départ du breton pour des raisons personnelles, a été mis en péril par la crise actuelle. Je ne sais pas ce qu’il en adviendra. J’aimerais beaucoup assister à une représentation de ce projet musical. En attendant, j’ai ce livre, À la ligne. Et c’est à chialer.
J’ai certainement choisi la pire période pour lire un bouquin pareil. Même dans mon petit jardin, à chaque fois que j’allais en lire des bouts, c’était claustrophobique. À la ligne, c’est le récit autobiographique de l’usine, de l’agro-alimentaire, des crevettes, des crabes et des poissons envoyés aux quatre coins de la France dans une première partie; des animaux découpés en tranches par des employés d’abattoir et de boucherie dans la deuxième partie. C’est méchant, cruel, teigneux. Sans ponctuation, à l’exception de quelques citations (entre autres : Braudel, Marx…). C’est des passages d’une tristesse incroyables, qui m’angoissent, et pas seulement ces descriptions méthodiques de la façon dont on découpe des langues de veau ou des mamelles de vaches. C’est aussi les personnes handicapées comme des “mongolitos”, les “petits pédés” qui peuvent s’assumer grâce à Taubira.
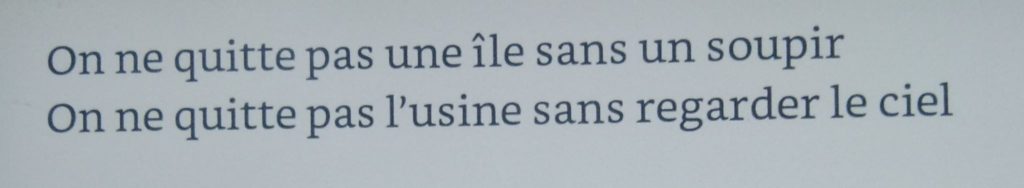
Et de ma part, décrire tout ça, c’est incroyablement arrogant, non? À la ligne me renvoie en effet à la fois à mon statut de petit privilégié, petit-bourgeois étudiant et profitant de conditions plus que confortables pour mes études. Quand Pontus dit qu’il emmerde les végétariens qui le font égoutter du tofu pendant des heures, c’est moi qu’il emmerde, moi qui ait fait le choix d’arrêter de manger de la viande. Et je l’absous parce que moi je n’ai rien à dire à un mec qui égoutte du tofu pendant des heures. Et rien que ça, c’est une certaine arrogance, non? C’est que j’ai suffisamment de recul pour lui dire ça. Je ne mange même pas de tofu, et je pense qu’il a quand même raison de m’emmerder, moi, le privilégié qui n’en égoutte pas. Je n’avais pas pris une telle claque depuis que j’avais entendu “L’Usine” de Bruit Noir, le projet de Jean-Michel Pirès et Pascal Bouaziz (ces connexions involontaires!).
À la ligne c’est aussi et surtout beaucoup de choses très belles. C’est décrire tout ce que l’usine, l’effort, la tristesse, les larmes, ont de magnifique, d’émouvant, sans jamais la moindre naïveté. Si on ne nous épargne pas le sang, le gras, la sueur, les larmes, les doigts coupés par les machines et les menaces des chefs, on ne nous épargne pas non plus l’amour d’une femme, ni celui d’une mère. Ni les vers de Trenet ou Barbara. Ni la colère, les références à Marx, à la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, ni cette invitation lancée à Macron, si l’envie lui venait de pousser des carcasses 8 heures par jour.
Je crois que ce genre de livres, cette littérature largement référencée dans le roman, de l’usine, elle me touche beaucoup. Je suis stupéfait par la justesse des mots que trouve Joseph Pontus pour parler de choses aussi laides et (en apparence) aussi dépourvues de valeur esthétique que l’usine. Et je l’ai dis, je me sens coupable d’être aussi touché par la beauté de ces mots. Encore un safari littéraire.