Robert Linhart – L’Établi
Il y a quelques années, je parlais, avec un ami, lors d’une discussion mouvementée, des possibilités d’actions que nous, pauvres étudiants, avions. Nous parlions de l’aliénation des travailleurs, de leur domination dans le travail. Il m’assurait (et je suis en colère en y repensant, alors que j’ai au fond de moi beaucoup de respect pour ce copain) que celui qui avait signé un contrat devait, si il était mécontent, soit partir, soit “fermer sa gueule”. Je me souviens lui avoir répondu, fatigué, triste, “et tu crois que c’est facile?”.
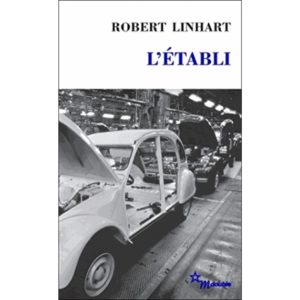
En 1968, Robert Linhart tentait quelque chose. Je connais déjà, Robert Linhart : j’avais eu l’occasion, à la fac, de lire un de ses livres, Le Sucre et la Faim, qui m’avait bouleversé. C’était un livre déprimé, triste, sur les ouvriers agricoles brésiliens, qui cultivent du sucre et ne gagnent même pas assez pour se nourrir. Même les rares réunions syndicales, organisées tant bien que mal dans le cadre de la dictature militaire, se devaient d’être accompagnées d’un petit buffet, car les gens qui viennent assister à cette réunion ont faim, et d’ici la fin de la réunion, ils auront de nouveau faim.
C’était en 2015. J’avais depuis ce moment là envie de lire L’Établi, le roman que Linhart avait tiré quelques années plus tôt de son expérience d’ouvrier “établi”, c’est-à-dire d’intellectuel instruit ayant choisi, comme certains de ses camarades après Mai 68, de “s’établir” dans des usines, dans une approche introspective et dans le même temps pour y organiser une résistance ouvrière, les syndicats étant considérés comme largement insuffisants.
C’est un des livres les plus beaux et les plus déprimants que j’ai lu depuis longtemps. Car ce que j’y vois, c’est aussi et surtout la quasi impossibilité de la lutte. Le lieu que Linhart choisit, une usine Citroën qui fabrique des 2CV à Porte de Choisy, est un endroit pourri. Les salariés ne peuvent s’y organiser, le travail est éreintant, la CGT timide côtoie le syndicat “jaune” de chez Citroën, et l’organisation du travail elle-même est raciste : les qualifications le sont. Vous êtes un bon français, vous êtes ouvrier spécialisé! Vous êtes arabe, vous serez manœuvre et payés moins, même si votre travail est plus qualifié! Ces ouvriers immigrés ont, par ailleurs, leur culture, leur propre organisation, comme seul moyen de résistance, et Linhart parle longuement de ces travailleurs étrangers.
L’usine, c’est une véritable prison (il n’aura pas attendu Foucault pour le sous-entendre), un lieu profondément disciplinaire où chaque geste est épié par des traîtres contremaîtres, où le travail lui-même devient un cadre répressif. Le monde que Linhart décrit est tout simplement dégoutant, un monde ou tout embryon de lutte sociale devient impossible.
Elle est pourtant là, la lutte. Il y a, pendant quelques chapitres, l’espoir, la grève. Lorsque Citroën décide de faire travailler gratuitement ses ouvriers 45 minutes par jour, rattrapant des acquis de Mai 68, Linhart peut enfin mettre en œuvre une défense. Un “comité de base” s’organise, des centaines de personnes refusent ce travail non payé et sortent du travail à 17H, pas une minute plus tard. C’est l’un des passages les plus émouvants du livre. “Nous briserons les murs de l’usine pour y faire pénétrer la lumière du monde”. Mais ce qu’il y a de plus terrible, c’est que cette grève est un échec.
La profonde tristesse qu’exprime Linhart me fait penser à Michelle Perrot, à son Mélancolie Ouvrière, à cette fameuse tristesse des lendemains de grève, à ces lendemains qui déchantent, où la joie et l’espoir disparaissent. Le destin des membres du comité de base est raconté comme le serait celui de soldats rentrant au pays après la grande défaite : ils démissionnent, sont même poussés à la démission par des instances patronales sadiques, s’assurant que leur travail devienne absolument insupportable, jusqu’à ce qu’ils craquent et quittent l’entreprise.
Et malgré tout, tout n’est pas noir. Linhart le souligne : les ouvriers, la classe ouvrière, sortent grandis de cette grève. Cette grève a une mémoire, on parle des années des héros de Choisy qui refusent de travailler pour rien et de se faire humilier, on résiste discrètement face à cet exemple, on en parle comme d’une bataille héroïque, fut-elle en soit un échec. Linhart en est persuadé : la classe ouvrière existe, et pendant une année, il en a fait partie, et même si il en a été licencié par des patrons qui connaissaient son statut de fauteur de troubles.
La lutte des travailleurs est-elle impossible? Qu’est-ce qui a changé depuis ces années qui me semblent, à ma lecture, apparaître comme d’un autre siècle (elles le sont, mais je songeais au siècle précédent)? Comment lutter dans un cadre si oppressif et si disciplinaire? Je remarque, ici ou là, des mots qui me touchent, qui m’évoquent ce travail que je détestais dans un café de gare, l’été dernier, je pense à cet ami que le travail à l’usine a plongé dans une profonde dépression. Je me rend compte, encore une fois, de ma situation de privilégié, de chanceux, d’hypocrite parfois, moi qui ne me suis jamais “établi” et qui me permet parfois de parler pour les travailleurs, moi qui suit un chanceux qui n’ait que bien peu travaillé à 22 ans.
Je me demande quoi faire.

